Séquoia
Un nom qui éveille notre imagination, utilisé à toutes
les sauces (de la maroquinerie au camping, en passant par l'informatique
ou l'immobilier). Il évoque les grands espaces de l'Ouest américain,
les Indiens et surtout... les arbres géants.
Des arbres géants venus d’un autre âge, au delà des
deux mille ans d’histoire.
Certains séquoias toujours debout
aujourd’hui étaient déjà centenaires quand
Jules César entrait en Gaule. Une réalité qui nous
donne le tournis. Des arbres lointains aussi, la Californie (leur
sanctuaire naturel) c’est
bien loin pour la majorité des Européens…

Et puis un beau jour au coin d’un parc, sur un grand boulevard
ou au creux d’une forêt : c’est la rencontre… En
voilà un, oui c’en est un : un séquoia géant,
ici, près de chez vous! Oh bien sûr ils n’ont
pas deux mille ans comme leurs grands-pères, mais l’Europe
est truffée de séquoias, du Portugal à la Finlande,
et de l’Irlande à la Roumanie.
Des semences de séquoias seront ramenées dans les bagages
des voyageurs à partir
de la seconde moitié des années 1850, accompagnées
des récits extraordinaires sur le Nouveau Monde et ses démesures. Des
séquoias seront plantés un peu partout. Ils survivront
et grandiront, dans les jardins publics ou botaniques bien sûr,
et dans les jardins des demeures et manoirs de la Belle
Epoque : signes extérieurs
de réussite de la Révolution Industrielle.
 Dans nos
jardins publics, le séquoia n'est souvent pas très loin.
Encore faut-il le reconnaître... © Marc Meyer
Dans nos
jardins publics, le séquoia n'est souvent pas très loin.
Encore faut-il le reconnaître... © Marc Meyer
|
 Agés de 100 à 150 ans maximum, les séquoias géants européens ont
déjà fière allure. ©Patrick Bradane
Agés de 100 à 150 ans maximum, les séquoias géants européens ont
déjà fière allure. ©Patrick Bradane |
Cette adoption concernera surtout le séquoia
géant. Elle
fût d’autant plus facile que l’arbre peut très
bien se planter de façon isolée, tant d’un point
de vue ornemental que sanitaire : l’arbre est particulièrement
résistant. Bien qu'aussi apprécié, le séquoia
sempervirens, moins résistant au gel, verra son aire de répartition
limitée par ce facteur
(zones maritimes ou océaniques tempérées).
De nos jours ces séquoias pointent fièrement au-dessus
du paysage. Pour un œil averti, il est relativement facile de les
distinguer à l’horizon, même à une certaine
distance (les « chasseurs de séquoias » qui
alimentent régulièrement l’inventaire ne me contrediront
pas).
Les grands spécimens, âgés de
100 à 150
ans, peuvent atteindre des circonférences autour des dix mètres
et des hauteurs allant jusqu’à 50 mètres. Ils sont
d’ors et déjà les plus grands arbres dans plusieurs
pays d’Europe ou ils le deviendront dans les années à venir.

Les séquoias à feuilles d'if sont bien présents dans la moitié ouest
de la France. Ici un bel exemple à Pau (Square Besson). © Nathaly Perez
Malgré cette importation réussie, le séquoia géant
ne s'est jamais reproduit naturellement en Europe. Le sempervirens non
plus, si ce n'est par rejet de souche. Ce sont donc des arbres non invasifs,
ils ne représentent
aucun danger pour la flore indigène. Parcontre le séquoia
géant est un
formidable allié en matière d'absorption de CO2 :
imaginez un instant les tonnes de carbone stockées pour des centaines
d'années dans un tronc
de plus de 10 mètres de circonférence et de 50 mètres
de haut ! Aucun autre arbre ne rivalise avec lui en ce domaine.
Rappelons que chez eux en Californie, nos deux séquoias cumulent les
records. Le séquoia géant est la plus grande créature vivante au monde
(le plus grand arbre du monde en volume), et le séquoia sempervirens
est quant à lui le plus grand arbre du monde en hauteur (115,5 m de haut).
Ces arbres exceptionnels méritaient bien un site
Internet à eux tout
seuls. Peut-être croisez-vous tous les jours sans le savoir un
séquoia
géant sur votre chemin? J'espère que ce site vous permettra
de mieux les apprécier.
Un seul nom pour deux arbres...
Trois arbres différents (en comptant le métaséquoia)
partagent ce joli nom chargé d’histoire, nom qui évoque plus communément les deux
espèces
californiennes : le séquoia
géant
(sequoiadendron giganteum) et le séquoia à feuilles d'if
ou séquoia
toujours vert (sequoia sempervirens). Cette double dénomination
engendre une confusion que l’on retrouve dans plusieurs langues
(secuoya en espagnol, redwood en anglais, etc.). Nombreux sont
les livres, articles, sites Internet qui mélangent allègrement
les deux espèces, attribuant à l’une les qualités
de l’autre. Une page
de ce site vous permet d’éviter
ce piège.
Il faut dire que la classification botanique des deux arbres ne se fit
pas sans mal, avec plusieurs modifications successives à travers
les décennies. D’abord classés dans un même
genre botanique (sequoia), nos deux arbres ont désormais leur
propre genre distinct, tout comme le troisième larron, car il
y en a un : le métaséquoia (appelé aussi séquoia
de Chine).
Tout commence avec le séquoia sempervirens. C'est logique, c'est un
arbre côtier, les Européens l'ont rencontré bien avant son cousin.
D'abord appelé taxodium sempervirens (1824), il sera rebaptisé Sequoia
sempervirens par Endlicher en 1847. Bien que la chose soit parfois
contestée, il est en général admis qu'Endlicher aurait choisi ce nom
en l'honneur du chef indien (cherokee) Sequoya.
 Sequoiadendron giganteum... âgé de deux mois!
Sequoiadendron giganteum... âgé de deux mois!
Après sa découverte de 1852, le séquoia géant se verra attribué toute
une série de noms successifs, en fonction du classement botanique de
l'arbre, ou du... patriotisme du botaniste!
Citons: Taxodium giganteum (Kelogg et Behr) - abandonné par
reclassification botanique, Sequoia gigantea (Torrey) - refusé
car déjà utilisé pour une sous-espèce de
sempervirens, Wellingtonia
gigantea (Lobb) - en l'honneur du vainqueur de Waterloo (Lobb
étant britannique!), fît scandale auprès des Américains (fraîchement indépendants), Washingtonia
californica (Winslow) - par réaction au précédent, refusé car
'washingtonia' désignait
déjà un palmier, Sequoia wellingtonia (Seeman)
- par tentative de compromis. Ce n'est qu'en 1938, soit 86 ans après
sa découverte, que Buchholtz mit tout le monde d'accord avec Sequoiadendron
giganteum.
Buchholz avait tout simplement démontré que les deux séquoias
ne faisaient pas partie du même genre botanique, tout en ayant bien
sûr des liens de
parenté.
L'histoire du métaséquoia est bien différente.
Connu seulement à l'état
fossile, cet arbre fût découvert en 1941, bien vivant, dans
la province de Sichuan en Chine. On le trouve désormais dans de nombreux
jardins publics. Proche du cyprès chauve, le métaséquoia a la particularité
de perdre son feuillage en hiver (contrairement aux deux autres séquoias). Bel arbre de croissance rapide, le métaséquoia est cependant loin d'atteindre les dimensions monumentales de ses deux compères californiens.
Sequoyah
Même si un doute subsiste quant à la motivation d'Endlicher
dans le choix du nom de séquoia, le nom du chef indien est désormais
associé au nom de l'arbre. Sequoyah est entré dans l'histoire pour avoir
créé l'alphabet cherokee. A partir de 1821, cet alphabet sera utilisé
par l'ensemble de la nation Cherokee. Il permettra la parution du premier
journal en langue amérindienne: le "Cherokee Phoenix". L'alphabet cherokee
sera également utilisé pour la rédaction de la Consitution Cherokee.
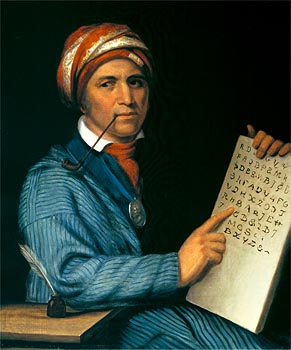
Déporté vers le "territoire indien", actuel
Oklahoma, Sequoyah quittera celui-ci pour se diriger vers le Mexique
où il décède en 1843. Le peuple
Cherokee n'apprendra sa mort qu'en 1845, soit deux avant qu'Endlicher
associe son nom aux plus grands arbres du monde. Il faut savoir qu' Endlicher
était non seulement botaniste mais aussi linguiste et grammairien.
Vu l'oeuvre accomplie par Sequoyah, le choix d'Endlicher paraît
d'autant plus évident.
Le futur : pas d'avenir sans racines...
En comparaison avec leurs cousins américains,
nos plus vieux séquoias
européens
ne sont finalement encore que des enfants. Nul ne peut dire aujourd'hui
s'ils atteindront les dimensions phénoménales que l'on
rencontre outre-Atlantique. Mais il semble bien que certaines parties
du continent présentent
des conditions optimales pour la croissance des séquoias. C'est
le cas de la façade ouest, du Portugal à l'Irlande, mais
aussi d'une large bande comprenant l'Alsace, le Baden-Wurtemberg et
la Suisse par exemple.
 Dans l'Exotenwald à Weinheim en Baden-Wurtemberg, ces
séquoias géants ont franchi
les 50 mètres de hauteur.© Atropa
Dans l'Exotenwald à Weinheim en Baden-Wurtemberg, ces
séquoias géants ont franchi
les 50 mètres de hauteur.© Atropa La pluviosité joue un rôle
majeur dans l'épanouissement des séquoias. Les modifications
climatiques en cours seront déterminantes sur leur développement.
Dans les régions qui ont connu des sécheresses
à répétition ces dernières années,
les grands séquoias dépérissent parfois très
rapidement. C'est que les besoins en eau du séquoia augmentent
avec sa croissance : un grand sujet a besoin d'une quantité d'eau
très
importante. Sachant que son éspérance de vie est au delà des 2000 ans,
un séquoia de 100 ou 150 ans est un jeune arbre en pleine croissance
: il ne va pas l'interrompre. Le jour où ses besoins en eau dépasse
le niveau que peut lui apporter son envrionnement, l'arbre franchit un
seuil fatidique et le dépérissement
s'amorce.
Le séquoia géant récolte jusqu'à 25% de
l'eau dont il a besoin via son feuillage, ce pourcentage peut osciller
entre 30 et 40% chez le séquoia sempervirens (l'arbre du brouillard).
Les séquoias
possèdent un système racinaire en étoiles. Les racines
courrent à l'horizontale
sous la surface et captent les eaux de pluie dans un rayon pouvant atteindre
30 mètres avec une profondeur maximale d'1m50. Ces arbres ne possèdent
pas de racine centrale verticale qui leur permettrait d'aller pomper
l'eau plus profondément lors des périodes plus sèches.
Ces deux facteurs mettent nos séquoias en bien mauvaise posture
lors de sécheresses ou de canicules
prolongées.
Un autre aspect déterminant pour l'avenir de
nos grands spécimens découle
également du facteur racinaire, à savoir le type de surface
dans l'alentour immédiat
de l'arbre. Beaucoup de séquoias géants ont été plantés
en milieu urbain. Si les sols aux alentours sont bitumés et empêchent
l'eau de percoler jusqu'au racines courant sous la surface, l'arbre
est condamné à plus
ou moins court terme (le fameux seuil de croissance évoqué précédemment).
 Le climat des Iles Britanniques convient
bien aux séquoias: ici au Jardin
Botanique de Benmore en Ecosse,
Le climat des Iles Britanniques convient
bien aux séquoias: ici au Jardin
Botanique de Benmore en Ecosse,
où pousse le plus grand séquoia géant européen
(54 mètres). Photo en provenance du site de Tim BekaertHeureusement pour eux et pour nous, il y a des séquoias
que l'implantation met à l'abri de ce
genre de mésaventures.
Ceux-là continueront leur
course vers le ciel. A quand les quinze mètres de circonférence?
Allez, je prends le pari : rendez-vous en 2025!


Retour |
|
|
